CGV
Conditions Générales de vente
• Écrivez-vous depuis longtemps ?
Paul Martin Gal : Oui, depuis mes 15 ans. Mais il m’a fallu du temps pour terminer une première nouvelle, et encore plus de temps pour être satisfait d’un texte fini ! J’écris pour le plaisir, dans les temps laissés libres par mon occupation professionnelle : et pas assez à mon goût.
• Comment l’écriture s’impose-t-elle à vous ?
P. M. G. : L’écriture part d’une idée, d’une atmosphère, d’un lieu ou d’un événement lu ou entendu, du passé ou très actuel, et qui éveille un écho chez moi. Ensuite, il faut organiser une trame narrative qui se tienne, un rythme et une atmosphère en rapport avec l’intention première de l’histoire, et pour y parvenir il faut pouvoir écrire en continu, pour que les connexions se fassent au mieux. Être immergé dans l’histoire, se laisser porter par le récit et se faire surprendre par le tour que prend l’histoire (au risque parfois d’aller dans une impasse narrative !), c’est très exaltant. Écrire en pointillé, de loin en loin, est possible, mais il y a le risque de perdre le fil, de rompre la densité du récit… C’est plus difficile.
• Est-ce votre première publication ?
P. M. G. : Une de mes nouvelles a été publiée dans une revue québécoise en 2010, mais mes envois de manuscrit aux maisons d’édition françaises spécialisées dans l’Heroic Fantasy n’avaient jusqu’alors pas été couronnés de succès…
• Au vu de la qualité de vos textes, on peut se demander pourquoi.
P. M. G. : Il y a peu d’éditeurs spécialisés dans l’Heroic Fantasy, et ils privilégient (c’est ce qu’un directeur de collection m’avait expliqué, et sa raison était valable) les romans ou les cycles longs, en plusieurs volumes, qui permettent au lecteur de retrouver un monde et des personnages familiers. Je comprends cela. Comme lecteur adolescent, j’ai été immergé dans l’œuvre de J.R.R. Tolkien, et c’est un plaisir exceptionnel. Quitter le monde des hobbits, des Orcs et des Elfes rend triste… d’où la primauté éditoriale aux grands cycles actuels.
• Pourquoi privilégier la nouvelle ?
P. M. G. : Le genre court, short story des Anglo-Saxons, en français la « nouvelle », impose une écriture plus dense. En quelques lignes, il faut poser un personnage, une situation, un espace, puis développer une action qui, dans un roman, pourrait occuper un chapitre et que l’on va rendre en quelques paragraphes.
La short story impose la densité, l’art de l’ellipse, et ces contraintes demandent une écriture efficace – c’est du moins ce que j’essaie d’atteindre. Écrire des nouvelles est un exercice de style que j’apprécie.
La dernière nouvelle du recueil, « La vallée de l’Homme mort », correspond à la dimension maximale acceptée par la revue québécoise qui en a publié la première version (10 000 mots) : cette contrainte m’a amené a aller à l’essentiel, à suivre l’action au plus près… Et le résultat est, je crois, efficace. Du moins j’espère que ce sera l’effet sur le lecteur !
• Qu’apporte la nouvelle par rapport au roman ?
P. M. G. : Développer une action dans ce genre littéraire (la nouvelle) implique une narration au plus près des personnages, et un suivi temporel condensé. Le lecteur regarde par-dessus l’épaule du héros, même si un aperçu du long temps ou un panorama plus large est toujours possible grâce à des incises chronologiques ou des chapitres introductifs, descriptifs, etc. Mais jamais trop longs. Transpirer avec le héros, sentir les odeurs de la forêt ou la pluie qui ruisselle, entendre le vent siffler dans un défilé : si le lecteur se trouve transporté à ce moment-là du récit, en oubliant d’où il lit, alors j’ai atteint mon objectif. Et c’est plus facile de garder cette densité sur un format court : le lecteur peut lire toute l’histoire d’un coup… Dans un roman, les descriptions sont plus longues, les explicatifs peuvent venir rompre l’atmosphère. En tant que lecteur, cela m’ennuie. Certains romans sont réussis, mais même le premier livre du Seigneur des Anneaux a des longueurs !
• La forme longue ne vous intéresse-t-elle pas ? Pourtant certains de vos textes sont des novellas de plus de 100 000 caractères.
P. M. G. : Quand j’entame l’écriture d’un texte, je ne me fixe pas de limite de longueur. J’ai une trame narrative en tête, mais pendant l’écriture, le récit peut prendre des directions imprévues, par le développement d’un personnage, d’une idée, etc. L’important est de garder le rythme, la cohérence narrative. Réaliser un sprint sur une longue distance est difficile ! Mais pourquoi pas ? Il me faudrait juste avoir un long temps d’écriture disponible devant moi – et aussi une histoire qui tienne la route. Or, des romans d’Heroic Fantasy, il y en a beaucoup, avec des mondes imaginaires cohérents. J. R. R. Tolkien a imaginé son univers sa vie durant : le résultat est fabuleux, mais cela empêche aussi la variété de thèmes, d’époque, de personnages. Or, ce que j’aime, c’est varier les atmosphères.
• Le fait que votre recueil de nouvelles se déroule en Afghanistan dans les années 30, laisse bien sûr songer à la série El Borak de Robert E. Howard. Est-ce un hommage ou une source d’inspiration ?
P. M. G. : C’est à la fois un hommage (les premières nouvelles, les plus anciennes, sont très proches du personnage de R. E. Howard), et une inspiration : je n’essaie pas de faire du Howard, mais de retrouver, dans mes récits, le rythme et l’atmosphère des nouvelles que j’ai aimés lorsque je l’ai découvert, il y a… quelques années déjà. C’était chez l’éditeur NéO, dans les années 1980. Les meilleurs nouvelles de Howard, quel que soit le personnage considéré, ont un rythme et une atmosphère uniques. Ses scènes de bataille sont époustouflantes – et décrire un combat est un exercice délicat : il faut le visualiser, puis le décrire de manière claire sans ralentir la lecture. À son meilleur, Howard a une écriture qui permet de visualiser des scènes précises tout en suggérant des univers complexes.
Si j’écris des nouvelles, c’est en grande partie en raison de l’impact qu’un recueil comme Le Pacte Noir (chez Néo) a eu sur le jeune lecteur que j’étais. Il explore des périodes historiques qui ont été rarement abordées (Vikings, Picts, Afghanistan des années 1930, western fantastique, sud des États-Unis, etc.). Aujourd’hui, sont disponibles des études littéraires qui éclairent son œuvre, sa vie, montrent ses sources d’inspiration. Dans les années 1980 et 1990, son œuvre était publiée avec très peu de commentaires : il était considéré, à juste titre, comme l’inventeur de l’Heroic Fantasy – juste avant Tolkien – et le créateur de Conan… S’il n’a écrit que des nouvelles, c’est parce qu’il répondait aux demandes des revues de l’époque. Mais ses meilleurs textes sont des chefs-d’œuvre de concision et de suggestion.

• Pourquoi cette passion pour Howard ?
P. M. G. : Beaucoup de ses textes ont pour point de départ une trame historique. Mêmes les aventures de Conan utilisent des référents culturels réels : Les clous rouges, ce sont les Aztèques ; ses Picts renvoient à la fois aux Indiens d’Amérique du nord et aux tribus celtiques du nord de l’écosse ; il y a des nouvelles qui empruntent aux légendes égyptiennes, ou aux Cosaques, etc. Et souvent, il nourrit son inspiration de lectures issues de ces cultures : les sagas islandaises pour les Vikings, les textes médiévaux irlandais pour les Celtes insulaires, sans oublier les textes classiques de la culture anglo-saxonne, comme Shakespeare ou, plus récent, Jack London, ou encore les textes antiques (l’Iliade, l’histoire de la Grèce et de Rome), les Croisades… Cette base historique, nourrie du genre littéraire ancien qu’est l’épopée (l’Heroic Fantasy n’est autre que de l’ « épopée fantastique », où un héros affronte des forces surnaturelles…), est aussi ce que j’aime lire et écrire.
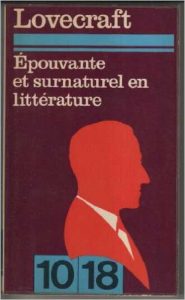
• Avez-vous écrit d’autres nouvelles s’inspirant de l’œuvre d’Howard ?
P. M. G. : Oui, des nouvelles sur les débuts de la Rome antique, où Gaulois, Romains et Étrusques s’affrontent, en une atmosphère assez proche, je pense, de certaines nouvelles de Conan ; une autre sur le Ve siècle après J.-C., sur le mur d’Hadrien, avec l’intervention des Picts… Ma dernière est un hommage à un autre personnage de Howard. Personne ne l’a encore lue, sauf mon fils !
• Avez-vous d’autres sources d’inspiration plus fantastique, comme Lovecraft (notamment à travers les créatures chtoniennes qui apparaissent dans vos nouvelles) ?
P. M. G. : H. P. Lovecraft a de peu suivi Tolkien dans ma découverte du fantastique anglo-saxon : j’ai tout lu de lui, je crois. C’est par son essai Épouvante et surnaturel en littérature que j’ai connu R. E. Howard, W. H. Hogdson, M. R. James, A. Machen et beaucoup des auteurs de la fin du XIXe et du début du XXe siècles. Je me suis mis à la recherche des écrivains de fantastique admirés par Lovecraft. Par chance, il existait des traductions de certains de ces auteurs en français, et puis les éditions NéO ont traduit beaucoup d’inédits : étudiant, je guettais chaque mois ces nouveautés.
• Vous êtes-vous inspiré de textes classiques ?
P. M. G. : Avant Tolkien et Lovecraft, j’ai lu l’Iliade et l’Odyssée : la plus ancienne épopée occidentale, et le plus ancien récit de voyage fantastique. Deux styles différents, des constructions narratives qui renvoient à des mondes complexes, à peine esquissés mais sous-jacents : l’Iliade débute par la colère d’Achille, on ne raconte pas les 10 ans de guerre qui précèdent ni la chute de Troie ; Ulysse raconte ses aventures… Quant aux combats et aux duels, ils sont décrits avec des évocations poétiques qu’on n’emploie plus aujourd’hui. D’autres textes révèlent les mentalités de ceux qui les ont composés, un système de pensée disparu : les sagas islandaises sont racontées sur un ton neutre alors qu’elles rapportent des récits d’exploits ou de vengeance sur plusieurs générations ; les textes irlandais débordent de fantastique ; l’histoire grecque et latine est une source de récits inépuisable, de même que les mythes grecs…
• D’autres inspirations plus récentes ?
P. M. G. : Plus récemment, R. L. Stevenson, R. Kipling, J. London, ou encore Poul Anderson, appartiennent à un type d’auteurs anglo-saxons qui pratiquent le récit d’aventure, privilégiant l’action sur l’intériorité des personnages. On découvre le personnage en suivant ses actions, pas ses pensées. Cela favorise le récit. C’est ce que j’aime.
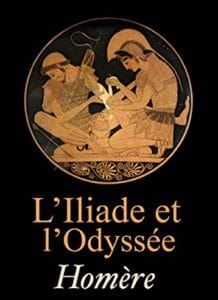

• En dehors de la littérature, avez-vous d’autres sources d’inspiration ?
P. M. G. : Le cinéma. Rio Bravo de Howard Hawks, sur un scénario de Leigh Brackett, l’auteur de science-fiction (mais les écrits de cette grande dame sont quasiment de l’Heroic Fantasy !), Lawrence d’Arabie de David Lean, les films de J. Huston, de Clint Eastwood ou de Ridley Scott créent souvent des mondes et des personnages inoubliables.
• Qu’aimez-vous relire ?
P. M. G. : Tolkien, relu deux douzaines de fois, je pense. Howard, du moins certaines nouvelles. Et les textes originaux, mythologiques ou épiques, de cultures historiques : cela nourrit l’imaginaire, en donnant accès à la fois à un vocabulaire tiré de ces langues et au cadre mental de ces peuples disparus.
• Il y a beaucoup d’aventures dans vos nouvelles, mais on y trouve aussi une grande érudition, votre formation d’archéologue vous a-t-elle servi ?
P. M. G. : L’archéologie conserve les vestiges matériels des cultures du passé. Pour reconstituer la manière dont ces lieux étaient utilisés, il faut avoir recourt aux textes, à l’histoire de l’art… Mais si l’Heroic fantasy se nourrit d’éléments réalistes, ces derniers ne sont que le cadre : ce qui prime est la trame narrative.
• Il y a une telle précision dans la description des lieux, de la population, etc. que cela laisse penser que vous vous êtes rendu en Afghanistan. Est-ce le cas ?
P. M. G. : Hélas non. J’ai lu El Borak dans les années 1980, au moment de l’invasion soviétique en Afghanistan. À ce moment-là, les Afghans se battaient pour leur liberté, et sans être naïf (il y avait déjà des groupes intégristes, qui s’en prenaient aux médecins occidentaux venus soigner les populations civiles), leur courage était remarquable. Entre Kipling, Howard et les récits des médecins français revenus d’Afghanistan ou des archéologues de la Délégation archéologique française en Afghanistan, est né Irvin Murray. Il se promène pour moi dans ce pays emplis de vestiges archéologiques uniques et de jeux tribaux séculaires.

• Lorsque vous décrivez les défilés d’Afghanistan ou les paysages du territoire yezidi, cela est fait avec une telle précision que le décor semble prendre vie sous nos yeux. Pourtant vous dites ne jamais vous être rendu sur les lieux : des logiciels comme Google Earth vous ont-ils aidé dans vos descriptions ?
P. M. G. : Pas vraiment : mes sources sont soit des ouvrages de voyageurs, qui décrivent pour le coup des choses vues et vécues, soit des recueils de photographies. Cela permet de visualiser les espèces végétales (par exemple), le type de paysage, les odeurs… puis de s’imaginer dans cet environnement naturel.
Le but est de faire sentir le sable sous les bottes ou, comme l’a fait R. L. Stevenson dans L’Île au trésor, de décrire au lecteur les éclaboussures du marin qui saute de la barque ! Avec Stevenson, on est sur la plage, avec l’odeur du sel, le cri des oiseaux de mer… et les pieds mouillés.
Donc pour l’heure, je n’ai pas eu recours à des vues satellites, mais… à de bonnes vieilles cartes !
• Prières en sikh ou en turc, interjections en pashtoun et en arabe…, votre roman porte la riche coloration de ses locuteurs.
P. M. G. : C’est un plaisir de jouer avec les mots de langues si différentes. Les Kafirs d’Afghanistan, les Sikhs, les Scandinaves, les Celtes… Leurs mots reflètent leur vision du monde : ce serait dommage de s’en priver.
• Avez-vous étudié ces langues ? les maîtrisez-vous ?
P. M. G. : Non. Déjà avec l’anglais, j’ai du mal… Mais en latin, je me débrouille ! Pour les autres langues, soit je me sers des termes lus dans certains ouvrages de voyageurs, soit je me sers d’un dictionnaire. Le danger est que, pour un locuteur, cela ne soit pas correct. J’espère avoir évité les fautes.
• Ce procédé rend votre recueil très vivant. Était-ce important pour vous ?
P. M. G. : Oui, car cela contribue à créer les personnages. Un Sikh ou un Afghan ne réfléchit pas comme un Romain ou un Pict, ou un Irlandais moderne ! À travers l’histoire racontée, j’essaie à la fois d’exprimer la diversité des cultures, et l’universalité des qualités humaines. Le courage, le désintérêt, l’humour aussi, le respect des femmes… Le héros possède suffisamment de ces qualités pour être libre d’être et de penser, et pour affronter le destin – quelles que soient les formes que revêt ce dernier.
Si j’apprécie la nouvelle, c’est parce qu’elle donne un cadre « classique » et exigeant à ce type de récit. Renouveler les conventions du genre est, je crois, plus difficile que les exploser. S’imposer des contraintes est fructueux. Mon objectif est que mon lecteur retrouve le plaisir que j’ai eu en lisant certaines des nouvelles de Howard, ou certains passages de Tolkien, de London ou de l’Iliade, et découvre des temps disparus et des hommes courageux. Si j’y suis parvenu, j’en serais heureux.
Propos recueillis par Chrystelle Camus
Note : depuis la rédaction de cette interview, le recueil de nouvelles La Cité des Lamentations a reçu le Grand Prix de l’Imaginaire pour l’ensemble de ses textes et un deuxième recueil relatant les aventures d’Irvin Murray est paru : Que cesse la nuit.

Conditions Générales de vente
Sed lex
Qui sommes-nous ?
Utilisez notre formulaire de contact
